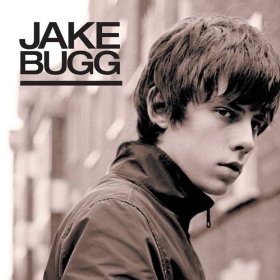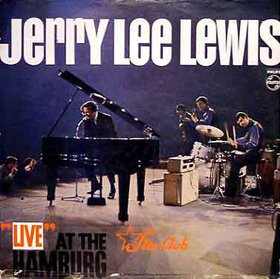Tracks : Everlasting Light ; Next Girl ; Tighten Up ; Howlin’ For You ; She’s Long Gone ; Black Mud ; The Only One ; Too Afraid To Love You ; Ten Cent Pistol ; Sinister Kid ; The Go Getter ; I’m Not The One ; Unknown Brother ; Never Give You Up ; These Days
Avec la fin de l’année 2019 qui approche, les classements de fin d’année vont bien évidemment fleurir. Ainsi que les classements des meilleurs albums de la décennie 2010-2019. Si ce genre d’exercice reste toujours aussi subjectif et particulièrement arbitraire (donc amusant), on peut largement parier sur le fait que les Black Keys seront -entre autres- salués comme faisant partie des artistes importants de ces dix dernières années.
Pourtant le duo originaire d’Akron dans l’Ohio a débuté sa carrière lors de la décennie précédente avec son premier album, The Big Come Up en 2002. Mais c’est réellement en 2010 et après que Dan Auerbach (chant, guitare, basse) et Patrick Carney (batterie et percussions) ont atteint le -très- grand public. C’est même en 2010 que leur renommée a littéralement explosé avec leur sixième album, Brothers. El Camino, disque suivant publié un an plus tard, porté par le giga hit Lonely Boy, ne fera qu’enfoncer le clou.
A l’heure du bilan décennal, se re-pencher sur Brothers (et El Camino une prochaine fois ?) parait donc une étape obligée. Ou a minima, une étape intéressante. Qu’est-ce qui fait de ce diptyque un quasi incontournable de ces dix dernières années ? Et qu’est-ce qui a changé entre les cinq premiers albums des Black Keys et ces deux-là ?
Beaucoup de choses, clairement, au (possible) désespoir des fans des Black Keys de la première heure. On retrouve sur cet album une approche, une patine, un son et des mélodies qu’on peut qualifier de beaucoup plus « pops ». Comprenez par là que les morceaux sont un peu éloignés du blues rock garage sale et référencé des débuts. Il reste bien entendu certaines références évidentes. En premier lieu, la pochette qui fait un gros clin d’oeil à The Howlin’ Wolf Album de 1969, album controversé du géant du blues du même nom. En deuxième lieu, la reprise de Never Give You Up, morceau de soul paru pour la première fois en 1968, vient rappeler dans quel terreau le duo plonge ses racines. C’est d’ailleurs un des meilleurs moments du disque. Et clairement depuis leurs débuts, les Black Keys sont des habitués des reprises soul/blues/rock, qui émaillent leurs précédents efforts avec plus ou moins de brio. Ils avaient même réalisé en 2006 un EP entier de reprises, Chulahoma: The Songs of Junior Kimbrough, bel hommage au bluesman du même nom.
Malgré ça, Brothers tranche assez nettement avec le blues rock crasseux de ses prédécesseurs. Notamment à cause de trois choses : la production de Danger Mouse, les mélodies beaucoup plus accrocheuses des morceaux et enfin les clips.
La production est clairement l’argument numéro 1 en faveur de cet album. Bien que Danger Mouse officiait déjà sur l’album précédent des Black Keys, Attack & Release paru en 2008, c’est bien sur Brothers qu’il trouve une formule miracle pour le duo. Loin du son sale de leurs débuts. On peut le déplorer. On peut aussi saluer l’approche, qui fait ressortir au mieux les influences plus soul du groupe. Pour l’anecdote, c’est d’ailleurs aux Muscle Shoals Sound Studios, situés en Alabama (et qui virent notamment passer Wilson Pickett, Otis Redding, Etta James, Percy Sledge, Aretha Franklin ou les Rolling Stones…), que l’album a été enregistré. Quelques sifflements sur Tighten Up, quelques vocalises basiques sur Howlin’ For You, tout en mettant moins en avant la guitare incandescente de Dan Auerbach donnent tout de suite une patine différente à cette galette. Les morceaux sont moins abrupts que leurs prédécesseurs, faisant aussi une plus grande place à la basse et aux claviers, renforçant le groove qu’ils dégagent. Et ils restent immédiatement en tête pour la plupart. Le duo ne s’y trompera d’ailleurs pas en reconduisant systématiquement Danger Mouse à la production de ses disques suivants, alors même que ce dernier enchaine les collaborations de haut rang depuis le début de sa carrière.
Petite parenthèse, je ne peux que vous conseiller par ailleurs l’écoute de Rome, son projet avec Daniele Luppi, Norah Jones et Jack White.
Bien sûr, une belle production ne suffit pas à faire un bon album. Et ce qui marque à l’écoute de Brothers, c’est à quel point les premiers morceaux sont accrocheurs et bons. Jusqu’à l’instrumental Black Mug, sixième piste du disque, c’est pour moi un sans-faute. Les tubes s’enchainent avec une aisance incroyable. C’est intelligent, très bien écrit, drôle et la plupart de ces morceaux restent quasi immédiatement en tête. De même, la fin du disque, plus orientée vers les morceaux calmes, est réussie. Le triptyque de morceaux qui concluent le disque (Unknown Brother ; Never Give You Up ; These Days) est particulièrement émouvant et beau.
Dernier élément qui a aidé à porter le disque, les clips. Les trois singles issus de cet album (Tighten Up ; Next Girl ; Howlin’ For You), en plus d’être trois excellents morceaux, ont aussi bénéficié de clips qui sont parmi les plus vus des Black Keys. Ils sont encore à l’heure actuelle tous les trois dans le top 7 des morceaux du groupe les plus vus sur youtube. Notamment grâce à l’humour (une des marques de fabrique du duo) qui s’en dégage. La bagarre d’enfants pour une petite fille qui fait écho à la bagarre des deux hommes pour une jeune femme dans le clip de Tighten Up est très drôle et j’avoue une passion sans bornes pour le clip de Next Girl avec la déambulation de cette marionnette de dinosaure au milieu de jolies filles… Le clip d’Howlin’ For You aurait presque pu quant à lui se retrouver au milieu du Diptyque Grindhouse de Tarantino et Rodriguez.
Cependant, une fois tous ces bons points soulevés, peut-on réellement parler de chef d’oeuvre à propos de Brothers? Ma réponse est non. Je considère qu’en effet, Brothers est un disque marquant des années 2010, pour tous les points soulevés précédemment. Mais j’ai cependant un gros reproche à lui faire. Le milieu du disque ne m’inspire rien. A part Ten Cent Pistol et son clavier cool (et son bon refrain), je n’aime aucun des morceaux entre Black Mud et Unknwon Brother. Ou plutôt, ce n’est pas que je ne les aime pas, mais c’est qu’ils ne me font rien. Je ne les retiens pas, n’y trouve pas grand chose de marquant et du coup je ressens une impression de vide lorsque je suis dans cette moitié du disque. Sentiment qui n’est d’ailleurs pas étranger au fait que c’est le plus long album de la carrière du duo, plus habitué à faire des disques autour de 35-40 minutes. De là à dire qu’une partie trop importante du disque est du remplissage? Pour moi, je crois que oui. Si l’album avait été plus court de 15-20 minutes, soit entre 3 et 5 morceaux en moins, je crois qu’il n’y aurait vraiment pas perdu au change.
C’est ce qui fait que je lui préfère son successeur El Camino. C’est ce qui fait aussi que bien que je considère cet album comme important pour les années 2010 et que je pense que tout amateur de rock de rock se doit de l’écouter au moins une fois, ce n’est pas pour moi un chef d’oeuvre. Juste un bon album de rock blues & soul. Ce qui est déjà pas mal.
14/20 (NB : La note exprime juste le plaisir que j’ai ressenti personnellement à l’écoute, non pas une note de la technique musicale, ou même de la valeur réelle de l’album en général. Elle permet juste d’indiquer mon échelle de plaisir ressenti ici.)
Moi-même.





![[Review Concert] Metallica Stade de France 12/05/2019](https://img.over-blog-kiwi.com/1/53/46/77/20190515/ob_2234ba_20190512-212838.jpg)